Description
Comment parler de l’Iran aujourd’hui ? Comment le faire lorsqu’on l’a quitté enfant et que la langue persane elle-même est devenue étrangère ? À ces questions, Sanaz Azari propose une réponse d’une simplicité toute philosophique. Quelque part en Belgique, dans une salle de classe, elle apprend à lire et à écrire sa langue maternelle. Sur son pupitre, un livre de lecture datant de la révolution islamique. Devant elle, un tableau noir, sur lequel le professeur, un iranien grisonnant, exilé lui aussi, trace avec minutie des mots et des phrases — pas si anodins. « Papa ne donne pas de pain, car il n’y a pas de travail », lit-on au tableau. De ces mots laborieusement déchiffrés, de ces images figées dans le temps, surgit quelque chose de bien plus vaste. C’est là la méthode que choisit Sanaz Azari, tout en modestie, pour questionner la révolution. Le choix d’une caméra subjective nous place à ses côtés, en position d’élève, attentifs aux plus petits détails, à l’écoute d’un professeur prompt à évoquer les événements de 1979 autant que le bon vin de Shiraz. Sa familiarité avec l’Iran, ses remords et sa nostalgie contrastent avec les hésitations, la laborieuse persévérance et les souvenirs lointains de la réalisatrice, qui cherche le chemin vers ce pays qu’elle ne connaît pas. Un chemin difficile et tortueux, comme celui de la révolution, au bout duquel une souris peut accoucher d’une montagne.
 Vf-Stream
Vf-Stream 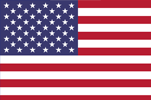
 YTS Streaming
YTS Streaming 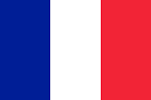
 123 movies
123 movies